La COP16 biodiversité entre espoirs et déceptions. Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, les acteurs internationaux redoublent d’efforts pour définir des réponses à la hauteur des menaces pesant sur notre planète. En effet, la biodiversité est essentielle au bon fonctionnement de la nature puisqu’elle désigne les différentes espèces (micro-organismes, végétaux, animaux) présents sur Terre. Toutes interdépendantes, notamment au regard de la chaîne alimentaire, il est primordial de protéger ces espèces pour assurer le maintien d’un certain équilibre. Or, le dérèglement climatique, par la modification de la température terrestre, l’acidification des océans, ou encore l’artificialisation des sols a conduit à la fragilisation de certaines espèces, voire même à l’extinction d’autres.
C’est dans cette perspective que s’est tenue, à Cali en Colombie, la COP16 biodiversité, sous l’égide de la Convention sur la diversité biologique (CDB), née lors du Sommet de la Terre de 1992. Moins médiatisée que les COP du climat, cette conférence rassemble tous les deux ans gouvernements, experts et défenseurs de l’environnement pour assurer le suivi des engagements pris, et identifier des priorités nouvelles dans la protection de la biodiversité mondiale.
La COP16 faisait suite à la COP15 de Montréal, qui avait conduit à l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Cet accord historique vise à protéger la nature à travers 23 objectifs d’ici 2030, tels que réduire l’usage des pesticides, réorienter 500 milliards de dollars de subventions actuellement alloués à l’agriculture intensive et aux énergies fossiles, ou encore allouer 200 milliards de dollars par an à la nature en augmentant les financements des pays en développement.
À Cali, l’enjeu était double : garantir les financements nécessaires à la réalisation de ces objectifs et instaurer un cadre commun de suivi pour évaluer les progrès de chaque pays. Parmi les questions à l’ordre du jour, figuraient la préservation des aires marines, la gestion des ressources génétiques, et la reconnaissance des droits des peuples autochtones, indispensables gardiens de la biodiversité.
Pourtant, alors que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres prévient de la crise existentielle qui nous menace, la COP16 s’est achevée sur un bilan mitigé, laissant planer des incertitudes quant à la viabilité des engagements pris en matière de biodiversité.
L’établissement d’indicateurs et de modalités de suivi des progrès réalisés dans la protection de la biodiversité
Un des objectifs majeurs de la COP16 était de définir les indicateurs et les modalités de suivi des avancées des États, dans la perspective d’une première évaluation à la COP17 de 2026. Cette démarche se voulait une continuité de la COP15, qui avait mis en place un mécanisme de rapport fondé sur des indicateurs partagés. La COP16 devait ainsi poser les bases de cet exercice d’évaluation, crucial pour mesurer l’impact des politiques de chaque pays.
Or, l’engagement de placer 30 % des terres et mers mondiales sous protection d’ici 2030 reste encore loin d’être atteint. Actuellement, seuls 17,6 % des terres et eaux intérieures et 8,4 % des océans et littoraux bénéficient d’une telle protection, montrant une timidité dans l’arrêt des méthodes destructrices de la nature (déforestation, surexploitation, extinction d’espèces). Alors que les pays devaient fournir des indicateurs fiables pour vérifier la réalité de leurs efforts lors de la prochaine COP, l’absence d’accord à la clôture de la Conférence témoigne d’un échec. Bien qu’un panel d’experts internationaux présents lors de la COP16 ait esquissé une feuille de route pour guider les gouvernements dans la création de marchés durables, aucun outil précis de suivi n’a été mis en place, laissant planer le doute sur la crédibilité des bilans à venir.
Le statut des peuples autochtones et le « partage » des bénéfices
Le statut des peuples autochtones, aussi, suscitait un vif débat. Acteurs essentiels de la préservation de la biodiversité, ils ne disposaient jusqu’alors que d’un groupe de travail sans statut officiel. Nombreux espéraient que cette COP16 leur accorderait un rôle reconnu au sein de la CDB, et ce fut le cas lors des derniers jours de la conférence. Dans la même lignée, un débat se posait autour de la question du partage des bénéfices liés au séquençage génétique des ressources effectué par les pays riches.
Ainsi, la reconnaissance des peuples autochtones au sein de la CDB marque un progrès symbolique. En effet, bien que représentant seulement 6 % de la population mondiale, ces communautés protègent 80 % de la biodiversité. Les signataires ont alors approuvé la création d’un groupe permanent dédié aux peuples autochtones et aux communautés locales. Ce nouvel organe de la CDB leur assure une place à la table des négociations, et chaque État s’engage désormais à préserver les connaissances et pratiques locales de ces peuples dans une optique de conservation de la biodiversité. « Les 196 pays membres ont reconnu la nécessité de notre pleine et effective participation », a déclaré Camila Romero, représentante des peuples Quechuas du Chili. Ce groupe permanent favorisera le dialogue entre États et peuples autochtones afin de renforcer la protection de la nature.
Par ailleurs, un consensus a été trouvé sur le partage des ressources provenant du séquençage numérique des ressources génétiques. Les informations génétiques numérisées représentent les données génétiques des plantes, animaux, et autres organismes vivants. Il s’agit d’informations codées issues de l’ADN d’une espèce. Grâce à ces informations, les scientifiques peuvent étudier et parfois même reproduire des composés actifs en laboratoire pour fabriquer des médicaments, des cosmétiques, ou des aliments. Elles permettent de créer des produits sans avoir à prélever directement les ressources dans leur habitat naturel, cela est notamment le cas de la vanille. Ces données sont souvent issues d’espèces se trouvant dans des pays en développement. Les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques, ou agro-industrielles, principalement dans les pays riches, utilisent ces informations pour fabriquer des produits qui peuvent générer des milliards de dollars. Cependant, les pays d’origine de ces ressources ne reçoivent souvent aucun bénéfice de cette exploitation, et contestent une forme de pillage de leurs richesses par les pays riches. Ainsi, la COP16 biodiversité a mis en place un mécanisme de financement, appelé le Fonds Cali, pour essayer de résoudre ce problème. Les entreprises seront tenues de reverser 1 % de leurs profits à ce fonds, lequel redistribuera ces ressources à parts égales entre les pays en développement et les peuples autochtones. Cependant, aucune contrainte n’accompagne cette décision, ce qui en affaiblit considérablement la portée. De plus, face aux larges bénéfices que font les pays riches sur ces séquençages génétiques, l’accès à seulement 1% de ceux-ci par les pays en voie de développement semble ne représenter qu’une fine contre-partie, témoignant d’une certaine hypocrisie de la part des pays riches dans le partage des richesses.
La question des financements
La question du financement, enfin, fut l’enjeu central des discussions. Le Cadre mondial pour la biodiversité (GBFF), fonds destiné à soutenir la lutte contre la dégradation de la biodiversité, nécessitera 200 milliards de dollars annuels d’ici 2030. Or, les divergences entre pays développés et en développement se sont intensifiées à Cali. Ces derniers réclament la création d’un nouveau fonds, géré par la COP, pour contourner les obstacles d’accès au GBFF actuel, trop dépendant de la bonne volonté des pays donateurs. Mais les pays riches, notamment l’Union européenne — Les Etat-Unis étant absents car ils n’ont pas signé la Convention — se sont montrés fermement opposés à cette initiative, craignant une dispersion des moyens financiers.
En outre, des pays comme la France et le Royaume-Uni ont proposé d’instaurer des « crédits biodiversité » pour attirer des financements privés dans la préservation du vivant. Ces crédits offriraient aux entreprises une occasion d’améliorer leur image et leur responsabilité sociale environnementale, en compensant les dommages écologiques de leurs activités. Toutefois, la proposition n’a pas échappé aux critiques d’ONG, dénonçant le risque de greenwashing (blanchiment écologique), de conflits d’intérêts, et la dépossession des populations locales. En effet, il semble peu probable qu’une entreprise telle que Total puisse compenser les catastrophes écologiques créées par ses activités pétrolières en finançant des projets visant à restaurer la biodiversité. À peine cette idée avancée, plus de 270 organisations avaient déjà signé une lettre ouverte contre ces crédits biodiversité, redoutant des répercussions pour les peuples autochtones, les petits producteurs, et les communautés locales. Ces crédits, en l’absence de régulation claire et précise, pourraient en réalité devenir une carte blanche à la destruction des écosystèmes, en échange de participations financières au fonds pour la biodiversité, annihilant totalement les effets de ceux-ci. Une telle critique est raisonnable lorsqu’on sait que les « les destructions occasionnées ne seront pas compensables », comme le souligne l’économiste Alain Karsenty. En contrepartie, certaines organisations de protection de la nature proposaient de créer des « certificats biodiversité » garantissant que les fonds financent des projets de préservation plutôt que des compensations. La logique ici serait de protéger les espaces encore sains de potentielles destructions, plutôt que d’en créer de nouveaux pour compenser ceux détruits.
Huit gouvernements ont promis de contribuer 400 millions de dollars au GBFF, avec une participation française de 5 millions d’euros. Bien que saluée, cette contribution reste loin des 200 milliards nécessaires d’ici 2030. En réponse à ce manque, les pays en développement ont renouvelé leur appel pour la création d’un nouveau fonds, proposition immédiatement rejetée par les pays riches. Alors que le Brésil soutenait la création de ce fonds, l’Union européenne, le Japon et le Canada s’y sont fermement opposés. Manque de temps, et du quorum nécessaire, la séance a finalement été suspendue sans trancher ce débat.
Les fameux crédits biodiversité, eux, ont été adoptés malgré leurs limites évidentes. « On ne peut pas compenser une perte à un endroit A en restaurant un écosystème à l’autre bout de la planète », avertit Sébastien Treyer, directeur de l’Institut du développement durable et des relations internationales. À Cali, il a exhorté la mise en place de marchés « crédibles et intègres ». Ainsi, pour encadrer ce marché naissant, un panel d’experts a publié une feuille de route éthique définissant le crédit biodiversité comme un « certificat qui représente une unité mesurable et prouvée de résultat positif pour la biodiversité”, ajoutant que ce résultat doit être durable. Cependant, l’absence de sanctions en cas de défaillance pourrait bien limiter la portée de ces engagements.
En conclusion
Malgré la déception générale, la COP16 a tout de même permis quelques avancées. Pourtant présentée comme un véritable succès par la Colombie, la COP16 qui a réuni près de 23 000 personnes, est un échec. L’absence de cadres précis pour évaluer les progrès des Etats dans la préservation de la biodiversité, à l’aune de la COP17, est décevante. Il en est de même pour l’absence d’accord réellement efficace et pertinent dans le financement de la biodiversité. L’incapacité des gouvernements à prendre des décisions rapides et efficaces au cours de cette COP16 souligne la lenteur de la lutte contre la crise écologique. En fin, les rares victoires notables de cette COP restent à nuancer, notamment eu égard aux caractéristiques du droit international, qui ne dispose aujourd’hui d’aucun mécanisme de sanction réellement efficace, soumettant ainsi la réussite des accords internationaux au bon vouloir des Etats. L’apparente incompatibilité des intérêts étatiques et des intérêts environnementaux ne permet pas d’espérer une grande évolution dans un avenir proche. La date de clôture des travaux ayant été reportée, la route vers la sauvegarde de la biodiversité semble encore longue et sinueuse.
Publication d’Emma Charpentier – Etudiante Master 2 Droit des libertés – Toulouse Capitole


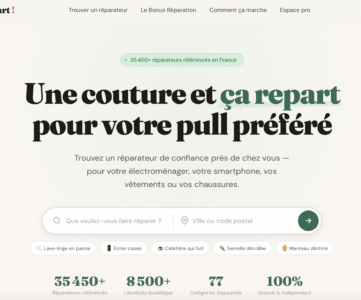










[…] En choisissant les paniers du Locominges, vous faites le choix d’un Noël solidaire et plus respectueux de l’environnement et de la biodiversité. […]