La posture anthropocentrée de Macron sur le loup, l’ours et les vautours : quand l’homme s’impose en maître de la nature
Les récentes déclarations d’Emmanuel Macron sur l’abattage des loups et des ours révèlent une vision réductrice de la cohabitation entre activités humaines et biodiversité, ignorant les véritables causes du dérèglement écologique.
Un discours populiste qui fait fi de la réalité scientifique
Lors de son déplacement dans l’Aveyron le 3 juillet 2025, Emmanuel Macron a plaidé pour empêcher l’implantation du loup là « où il y a du pastoralisme », quitte à autoriser qu’un plus grand nombre de canidés soient abattus. Le chef de l’État a notamment argué que la présence de l’ours, du loup « et même du vautour » conduisait les éleveurs à laisser leurs bêtes « en bas ». « Et donc on a des terres qui redeviennent de la friche, de la broussaille et du coup qu’est ce qui se passe : je vous le parie, dans quatre ans, on aura des incendies », a-t-il appuyé.
Cette sortie présidentielle a provoqué l’indignation immédiate des défenseurs de l’environnement. Jean-David Abel, pilote du réseau biodiversité de France Nature Environnement, a accusé Emmanuel Macron de faire « un exercice de populisme d’un niveau rare en affirmant des choses totalement mensongères ». Une critique cinglante qui pointe du doigt la déconnexion entre le discours présidentiel et la réalité du terrain.
Une argumentation qui inverse les responsabilités
Le président français développe une rhétorique qui fait des grands prédateurs les responsables de la dégradation des territoires de montagne et du risque d’incendie. Cette vision anthropocentrée occulte pourtant une réalité historique fondamentale : le loup est « déjà installé depuis 25 à 30 ans dans des territoires où il y a du pastoralisme depuis des siècles », comme le rappelle Jean-David Abel.
En réalité, ce sont bien les activités humaines qui ont, en premier lieu, exterminé les loups et les ours de nos montagnes. La disparition du loup de France au début du XXe siècle résulte d’une campagne d’éradication systématique menée par l’homme. Sa réapparition naturelle dans les années 1990, depuis l’Italie, constitue un phénomène de recolonisation spontanée et non une « réintroduction » artificielle, contrairement à ce que suggèrent parfois les discours politiques.
Le véritable responsable des incendies : le réchauffement climatique
Les associations environnementales dénoncent des « fakes sur le loup qui serait la cause des incendies ». Cette accusation présidentielle détourne l’attention des véritables causes des incendies de forêt : le réchauffement climatique, la sécheresse croissante, et paradoxalement, l’abandon de certaines pratiques pastorales traditionnelles dues à l’exode rural et aux mutations économiques.
Les scientifiques sont formels : l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies en Europe est directement liée aux températures plus élevées, à la diminution des précipitations estivales et à l’allongement des périodes de sécheresse. Accuser les prédateurs de favoriser les incendies en dissuadant le pastoralisme relève de la diversion politique plutôt que de l’analyse factuelle.
Une protection déjà fragilisée par les lobbies
Le président se fonde notamment sur la récente décision au niveau européen de déclasser le statut du loup, devenu une espèce « protégée » et non plus « strictement protégée ». Cette évolution, portée notamment par Ursula von der Leyen après que son poney ait été tué par un loup, illustre comment des considérations personnelles et politiques peuvent influencer les décisions de conservation.
Selon un décompte officiel publié fin juin, 64 loups ont été « détruits légalement » en 2025, le plafond autorisé étant 192, et 11 illégalement. Ces chiffres révèlent une pression déjà considérable sur une espèce dont la population française est estimée à environ 1 000 individus.
Les indemnisations : une réalité occultée
L’argument selon lequel les éleveurs subissent des préjudices économiques insurmontables néglige l’existence de systèmes d’indemnisation. Les exploitants victimes d’attaques de prédateurs bénéficient de compensations financières pour les animaux perdus, ainsi que d’aides pour l’installation de moyens de protection (parcs électrifiés, chiens de protection, bergers).
La ministre de l’Agriculture Annie Genevard avait indiqué le 28 mai devant le Sénat qu’à la date du 12 mai, « ce sont déjà 759 attaques et 2.617 bêtes prédatées », causant des « préjudices considérables ». Toutefois, ces chiffres doivent être mis en perspective avec l’importance du cheptel national et l’existence de mécanismes de compensation.
Une vision scientifiquement contestable
Les experts en biodiversité rappellent qu’« exclure les loups des zones d’élevage n’est pas réaliste et ne relève d’aucun fondement scientifique. Les loups vivent dans de grands territoires qu’il est impossible de diviser », comme l’explique Cédric Marteau de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Contrairement aux affirmations présidentielles, « ces dernières années, il n’y a absolument pas eu une augmentation des attaques. Il y a eu effectivement une augmentation de la répartition géographique de l’espèce. Mais les attaques, ça fait plusieurs années qu’au niveau national, elles baissent ». Dans l’arc alpin, où se concentrent 80 à 90% des loups français, les attaques diminuent même continûment.
L’anthropocentrisme au cœur du problème
La position présidentielle illustre parfaitement une vision anthropocentrée de la nature, où celle-ci n’existe que pour servir les intérêts humains immédiats. « Tous les gens qui inventent des règles et qui ne vivent pas avec des bêtes dans des endroits où il y a l’ours qui redéboule ou le loup, qu’ils aillent y passer deux nuits », a lancé le chef de l’État, réduisant le débat écologique à une opposition binaire entre citadins « déconnectés » et ruraux « pragmatiques ».
Cette rhétorique ignore que la biodiversité constitue un patrimoine commun de l’humanité, et que la préservation des écosystèmes bénéficie à l’ensemble de la société. Les services écosystémiques rendus par les prédateurs – régulation des populations d’herbivores, maintien des équilibres naturels – profitent à tous, y compris aux activités humaines.
Le retour du sauvage : une richesse, pas une menace
Contrairement au discours présidentiel, le retour spontané du loup témoigne de la résilience des écosystèmes et constitue un indicateur positif de la qualité environnementale. La recolonisation naturelle de certains territoires par la faune sauvage représente une victoire écologique, fruit des efforts de protection menés depuis des décennies.
La nature n’a effectivement pas besoin de l’homme pour exister et se développer. Elle a même démontré, pendant les confinements liés à la pandémie, sa capacité remarquable à reprendre ses droits dès que la pression anthropique diminue. Cette autonomie du vivant devrait inciter à plus d’humilité face aux processus naturels.
L’exemple encourageant de Melles : une cohabitation possible
Le territoire de Melles, dans les Pyrénées, offre un exemple concret de cette cohabitation possible entre activités humaines et grands prédateurs. Cette commune accueille aujourd’hui une quinzaine d’ours sur son territoire, démontrant que la présence de ces plantigrades n’empêche pas la vie locale de se poursuivre. Plus récemment, un loup a été photographié par une caméra forestière dans la région, marquant potentiellement le retour de cette espèce dans les Pyrénées après des décennies d’absence.
Si l’on ne sait pas encore si ce loup était simplement de passage ou s’il était présent avec d’autres congénères, sa présence durable constituerait incontestablement une excellente nouvelle pour la biodiversité pyrénéenne. Cette situation illustre parfaitement que le “retour du sauvage” tant redouté par certains discours politiques peut s’effectuer sans catastrophe, pourvu que l’on accepte de partager l’espace avec les autres espèces.
Vers une cohabitation apaisée ?
Les associations environnementales prônent une approche différente : « L’enjeu est de poursuivre le travail entrepris avec les éleveurs et de procéder au renforcement des mesures permettant de limiter les interactions avec les troupeaux ». Cette voie, plus exigeante que les solutions expéditives, nécessite du temps, des moyens et une volonté politique réelle.
L’expérience d’autres pays européens, notamment l’Italie et l’Espagne, démontre qu’une cohabitation équilibrée entre prédateurs et élevage reste possible. Elle requiert cependant un accompagnement technique et financier des éleveurs, ainsi qu’une évolution des pratiques pastorales traditionnelles.
Conclusion : repenser notre rapport à la nature
Les déclarations présidentielles sur les grands prédateurs révèlent une approche court-termiste et politicienne d’enjeux environnementaux complexes. En cédant aux pressions du lobby agricole, Emmanuel Macron tourne le dos aux engagements internationaux de la France en matière de biodiversité et perpétue une vision dépassée des relations homme-nature.
Comme l’a dénoncé l’association One Voice, ces positions font du chef de l’État « un fossoyeur des loups et de tous les animaux sauvages pour mieux flatter les lobbies de l’élevage et de la chasse ». Au-delà des considérations partisanes, cette controverse interroge notre capacité collective à dépasser l’anthropocentrisme pour construire un modèle de développement respectueux du vivant.
La véritable urgence écologique ne réside pas dans la « régulation » des prédateurs, mais dans la réduction drastique de notre empreinte climatique et la préservation des derniers espaces sauvages. Face aux défis du XXIe siècle, la nature demeure notre plus précieux allié, à condition de cesser de la considérer comme un simple réservoir de ressources à exploiter. Car en définitive, protéger la biodiversité, c’est nous protéger nous-mêmes.




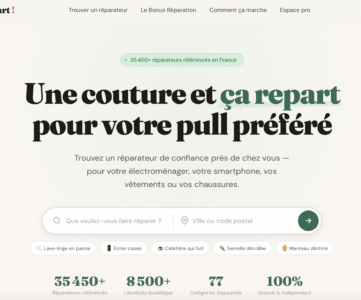

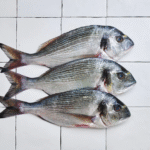


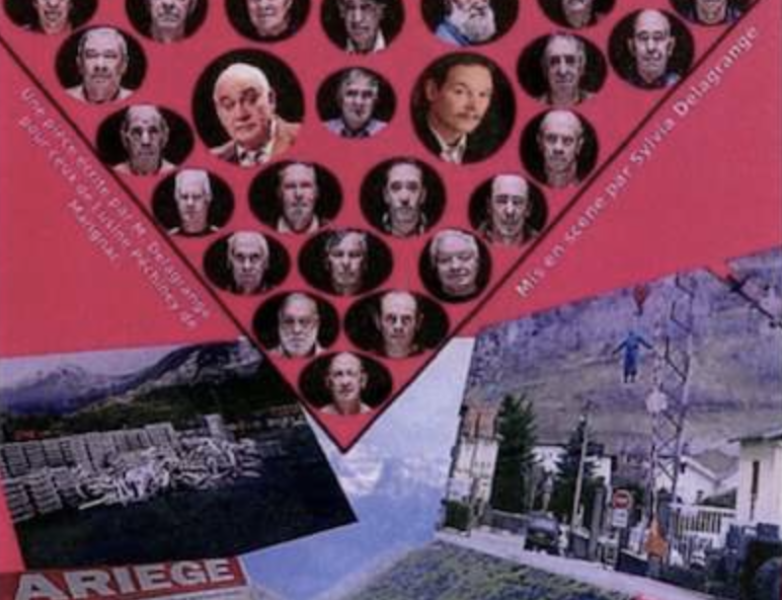



[…] des aspects écologiques, le loup fascine. Il nourrit l’imaginaire collectif, les contes, les légendes, les peurs […]