30 000 voyageurs en trois mois, mais quelle réalité pour les habitants du territoire ?
Trois mois après sa réouverture le 22 juin dernier, la ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon affiche un bilan qui fait consensus dans les communiqués officiels : plus de 30 000 voyageurs ont emprunté ce train qui avait disparu pendant une décennie. La Région Occitanie se félicite de ce résultat, preuve selon elle que « nos concitoyens font le choix du train lorsque l’offre est au rendez-vous ». Mais derrière ces chiffres (bien orchestrés) apparemment encourageants se cache une réalité plus nuancée, qui interroge sur la véritable nature de ce succès et sur l’avenir du territoire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la communication est faite dans le sens Montréjeau-Luchon … mais ces premiers chiffres servent la soupe à Carole Delga fervente défenseur de l’A69.
Un train pour les touristes, pas pour les habitants
Lorsqu’on analyse de près ces 30 000 passages, une évidence s’impose : il s’agit principalement d’une fréquentation touristique et événementielle. La Région elle-même l’assume dans sa communication en mettant en avant les « offres attractives » développées avec les acteurs économiques locaux. Des billets à tarif préférentiel pour les grands événements sportifs comme le Luchon Aneto Trail ou le passage du Tour de France, des forfaits combinés pour accéder aux thermes de Luchon, et bientôt des packages « Skirail » pour rejoindre les stations de Peyragudes et Superbagnères.
Ces initiatives sont certes louables et contribuent à l’attractivité touristique de la vallée. Entre le ski sous perfusion de neige artificielle, le brame du cerf transformé en produit d’appel touristique, et le trail érigé en nouveau marqueur de réussite sociale, quelle cohérence avec la transition écologique tant proclamée ? Et qu’en est-il des besoins quotidiens des habitants ? Avec seulement 6 allers-retours par jour et 5 points d’arrêt entre Montréjeau et Luchon, l’offre reste largement insuffisante pour permettre une véritable alternative à la voiture pour les déplacements du quotidien. Faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical, accompagner ses enfants à l’école ou aller travailler dans une commune voisine : autant d’activités qui nécessitent une flexibilité et une fréquence que cette ligne ne peut offrir dans sa configuration actuelle.
Le territoire reste donc condamné à une dépendance automobile quasi totale pour sa vie locale. Les 67 millions d’euros investis par la Région pour remettre en état cette infrastructure bénéficient avant tout à une économie touristique saisonnière, tandis que les résidents permanents continuent de prendre leur voiture pour se déplacer. Un paradoxe qui questionne les priorités en matière d’aménagement du territoire et de transition écologique.
Des déplacements décarbonés dans un territoire qui ne l’est pas
Certes, on ne peut nier que chaque trajet effectué en train plutôt qu’en voiture individuelle représente une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réouverture de cette ligne s’inscrit dans une volonté affichée de promouvoir les « mobilités décarbonées », et c’est indéniablement un point positif. Mais cette vitrine verte ne doit pas faire oublier que le territoire lui-même reste largement en décalage avec les impératifs de la transition écologique.
Un territoire tourné vers l’élevage intensif
Au-delà du tourisme, l’économie locale de la vallée repose en grande partie sur l’agriculture et notamment l’élevage. Or, tous les rapports scientifiques convergent : la production de viande, et particulièrement de viande bovine, figure parmi les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre. Méthane produit par les ruminants, déforestation pour les cultures fourragères, consommation d’eau considérable : l’élevage concentre de nombreux impacts environnementaux qu’il devient urgent de réduire.
Les recommandations des experts en nutrition et en environnement sont claires : il faudrait diviser par deux notre consommation de produits animaux pour respecter les objectifs climatiques. Pourtant, dans cette vallée pyrénéenne comme ailleurs, l’élevage reste une activité économique centrale, soutenue par des aides publiques et valorisée comme un patrimoine culturel intouchable. Comment prétendre s’engager dans une transition écologique tout en maintenant un modèle économique qui en contredit les fondements ?
L’illusion de l’écoresponsabilité en station
L’hiver approchant, la Région Occitanie met en avant son futur forfait « Skirail » qui permettra de combiner train et accès aux remontées mécaniques des stations de Peyragudes et Superbagnères. Une initiative présentée comme un moyen de « limiter l’impact écologique des sports d’hiver ». Mais là encore, il convient de regarder au-delà de la communication.
À Luchon-Superbagnères, comme dans la plupart des stations de moyenne montagne, on nous explique que les canons à neige sont devenus « écoresponsables ». Un discours marketing qui peine à masquer la réalité : ces équipements consomment des quantités considérables d’eau et d’énergie, dans des territoires où la ressource en eau devient de plus en plus précaire avec le réchauffement climatique. Fabriquer de la neige artificielle pour maintenir une activité économique saisonnière dans un contexte de bouleversement climatique, est-ce vraiment de l’écoresponsabilité ?
La Région a investi 3 millions d’euros dans la nouvelle télécabine « Crémaillère Express » menant à Superbagnères. Une infrastructure moderne, sans doute, mais qui s’inscrit dans une logique de développement continu du tourisme de masse en montagne, alors que les hivers raccourcissent et que l’enneigement naturel devient de plus en plus aléatoire. Plutôt que d’accompagner une adaptation au changement climatique, on continue de miser sur un modèle complètement dépassé qui a de moins en moins d’avenir.
Un investissement conséquent, mais pour quel projet de territoire ?
Au total, la Région Occitanie a investi plus de 110 millions d’euros dans la vallée depuis 2016. C’est considérable, et cela témoigne d’une volonté politique de ne pas abandonner ces territoires ruraux de montagne. Les 67 millions d’euros consacrés à la remise en état de la ligne ferroviaire représentent un effort financier important, d’autant que l’Occitanie est devenue la première région française à obtenir la gestion directe d’une ligne ferroviaire et à réaliser elle-même les travaux.
Mais cet investissement massif pose une question essentielle : pour quel projet de territoire ? Si l’objectif est de faire de la vallée de Luchon une « destination touristique incontournable des Pyrénées », comme l’affirme la présidente de Région Carole Delga, alors les moyens sont cohérents avec l’ambition. Les rénovations des thermes, la nouvelle télécabine, les forfaits combinés train-ski, tout converge vers une intensification de l’activité touristique.
Mais si l’on souhaite réellement accompagner la transition écologique, réduire la dépendance à la voiture, diversifier l’économie locale et adapter le territoire aux défis climatiques, alors les choix d’investissement semblent partiellement en décalage. Pourquoi ne pas avoir privilégié une fréquence de trains beaucoup plus élevée, avec un format de train plus sobre, avec des horaires adaptés aux besoins des travailleurs et des étudiants ? Pourquoi continuer à développer les infrastructures de ski alpin plutôt que d’accompagner une véritable mode de vie à la montagne ?
Des signaux encourageants malgré tout
Il serait injuste de ne voir que les aspects négatifs de cette réouverture. Les 30 000 voyageurs en trois mois démontrent qu’il existe un réel appétit pour le train, y compris dans des zones rurales qu’on disait condamnées à la voiture individuelle. C’est la preuve qu’avec une offre visible et des tarifs attractifs, les comportements peuvent évoluer (même s’il s’agit d’une mobilité opportuniste dans le cas présent).
Les opérations « billets à 1 euro » tous les premiers week-ends du mois constituent une belle initiative pour rendre les déplacements en train accessibles au plus grand nombre. La volonté de proposer des forfaits combinés avec les thermes ou les stations de ski montre une recherche de cohérence dans l’offre touristique.
Et surtout, cette ligne rouvre après dix ans de fermeture. Dans un contexte où tant de petites lignes disparaissent définitivement, le simple fait de remettre en service une infrastructure ferroviaire mérite d’être salué. C’est un signal politique fort, qui dit que ces territoires ne sont pas abandonnés et qu’on peut encore y croire.
Aller au-delà de la communication
Le vrai défi ne sera pas de maintenir 30 000 voyageurs par trimestre (des chiffres sur un été). Il sera de faire progressivement de cette ligne un outil de transformation du territoire, et pas seulement un accessoire touristique. Cela suppose d’augmenter significativement la fréquence des trains, d’adapter les horaires aux besoins réels des habitants, de développer les correspondances avec d’autres modes de transport doux comme le vélo.
Cela suppose aussi de repenser le modèle économique du territoire dans son ensemble. Comment accompagner les agriculteurs vers des pratiques moins émettrices ? Comment diversifier l’économie touristique pour la rendre moins dépendante des aléas climatiques ? Comment développer des activités génératrices d’emplois qui ne reposent pas uniquement sur le tourisme saisonnier ?
La transition écologique n’est pas qu’une question de moyens de transport. C’est une transformation globale qui touche tous les aspects de notre vie collective : production, consommation, habitat, loisirs. Tant que les investissements publics se concentreront sur l’amélioration à la marge d’un modèle qui reste fondamentalement inchangé, on restera dans une logique de communication verte plutôt que de véritable transition.
Un succès à nuancer
Les 30 000 voyageurs de la ligne Montréjeau-Luchon méritent d’être célébrés, mais pas de manière inconditionnelle. Ils témoignent d’un succès touristique réel, d’une capacité à attirer les visiteurs vers ce territoire pyrénéen par le train plutôt que par la route. C’est une bonne nouvelle pour l’image de la vallée et pour son économie touristique (et pour la communication de Carole Delga).
Mais pour les habitants qui y vivent à l’année, peu de choses ont vraiment changé. Ils continuent de dépendre de leur voiture pour tous leurs déplacements quotidiens. Le territoire continue de miser sur des activités économiques dont la compatibilité avec les enjeux climatiques est pour le moins discutable. Et la communication autour de l’écoresponsabilité masque mal la persistance d’un modèle de développement qui n’a pas fondamentalement évolué.
La réouverture de cette ligne est une étape. Elle ne sera réellement significative que si elle s’inscrit dans un projet plus large, plus cohérent, plus ambitieux en matière de transition écologique et d’aménagement du territoire. Reste à savoir si elle sera suffisamment forte pour aller au-delà des effets d’annonce et transformer durablement la vallée de Luchon.
En attendant, saluons ces premiers résultats tout en gardant un regard lucide sur leurs limites. Et continuons de poser les questions qui dérangent, car c’est ainsi que naissent les véritables transformations.








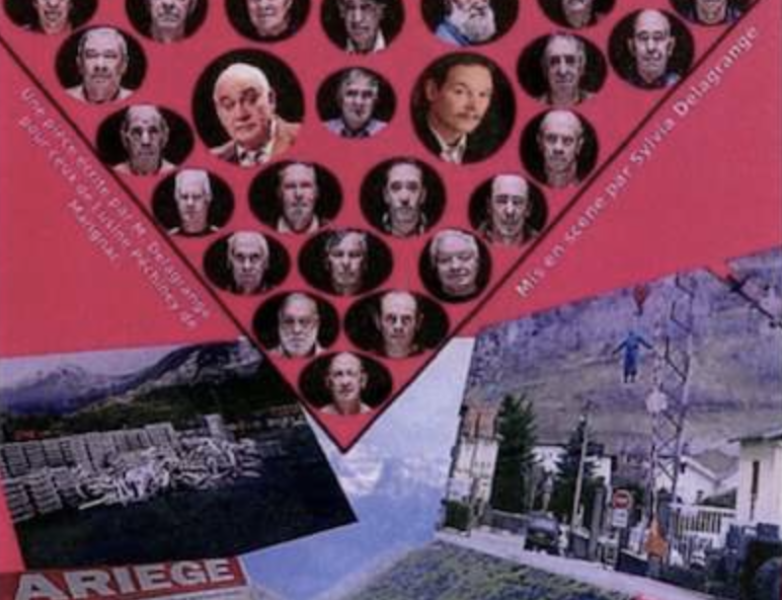



[…] Après une décennie de silence, les rails entre Montréjeau et Luchon résonnent à nouveau du passage des trains. Cette réouverture, fruit d’un investissement public de 67 millions d’euros porté par la région Occitanie, s’inscrit dans une démarche ambitieuse de transition vers une mobilité plus durable. Après un été de réouverture, la région Occitanie annonce 30 000 voyageurs sur les trois mois de la saison estivale sur la ligne de train Montréjeau-Luchon. […]