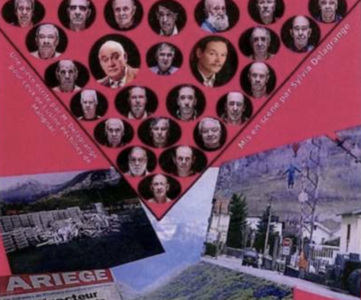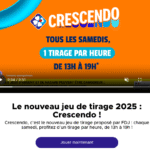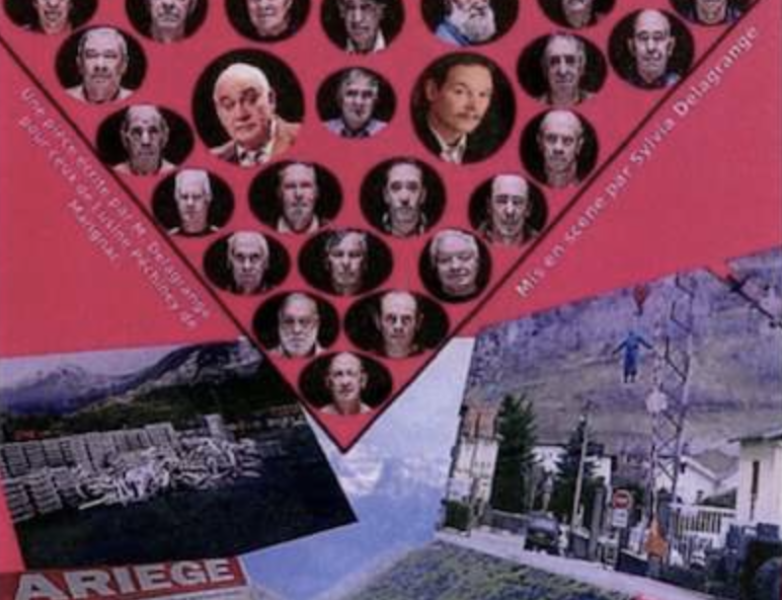Tout est parti d’ici
Quand Saint-Marcet a révélé le secret d’une industrie française
Le 14 juillet 1939, la campagne commingeoise bascule. À Latoue, une commune du Comminges en Haute-Garonne, un forage enfonce son outil à 1500 mètres de profondeur. Ce jour-là jaillit un gisement de gaz naturel qui changera le cours d’une région. Ce premier gisement d’hydrocarbures en France devient le berceau d’une histoire industrielle méconnue, celle que le documentaire Tout est parti d’ici s’apprête à raviver aux cinémas Rex de Luchon.
La découverte qui change tout
La découverte du gisement de Saint-Marcet n’est pas le fruit du hasard. Depuis les années 1920, le géologue Léon Bertrand observe le sous-sol des Pyrénées. Il sait que les structures géologiques de cette région présentent les conditions favorables aux hydrocarbures. Son intuition s’appuie sur une compréhension fine des plis anticlinaux des petites Pyrénées, des véritables pièges naturels pour le pétrole et le gaz. Bertrand, né en 1869 et spécialiste renommé du piémont pyrénéen, a consacré vingt ans à l’étude de cette région. Avec son collaborateur Louis Barrabé, géologue également expert des Pyrénées, il formule une hypothèse simple mais audacieuse : la structure anticlinale entre Saint-Marcet et Saint-Martory pourrait abriter un gisement d’hydrocarbures.
Après la Première Guerre mondiale, la France comprend l’enjeu stratégique du pétrole. Sans essence, les avions ne volent pas, les camions ne roulent pas. Le gouvernement se rend compte que l’Amérique fournit plus de 80% du pétrole mondial, créant une dépendance dangereuse pour un pays à la stabilité géopolitique incertaine. Le gouvernement lance une grande campagne de prospection. Entre 1920 et 1935, les permis de recherche se distribuent à travers le territoire, particulièrement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Le Centre de Recherches du Pétrole du Midi, basé à Montpellier, coordonne ces efforts. C’est dans ce contexte qu’en 1939, l’Office national des Combustibles liquides ordonne le forage du site de Latoue, situé à proximité de Saint-Marcet, pour vérifier enfin les hypothèses des géologues.
L’équipe de forage, dirigée par Louis Barrabé assurant la supervision géologique, descend l’outil à travers les couches géologiques. À 1500 mètres de profondeur, une brèche révèle sa richesse : un jailissement de gaz à haute pression. C’est une découverte majeure, d’une portée immédiate pour la sécurité énergétique nationale. Le sous-sol français contient réellement des hydrocarbures, confirmant les intuitions des prospecteurs. Des forages supplémentaires sont lancés au cours de l’été 1939, rapidement, avant l’arrivée de la guerre. Ils confirment la présence de pétrole liquide, accompagné d’eau salée, qui jaillit pendant 24 heures lors de certains forages. Le gisement s’étend sur plusieurs communes autour de Saint-Marcet, révélant une réserve importante qui alimentera les rêves d’indépendance énergétique française.
La naissance de la Régie autonome des pétroles
Deux mois à peine après le jailissement du gaz, la France entre en guerre. Malgré ce contexte troublé, le gouvernement agit rapidement. Le 29 juillet 1939, moins de deux semaines après la découverte, un décret-loi crée la Régie Autonome des Pétroles (RAP), établissement public doté d’une autonomie financière. Cette création rapide démontre la conscience des enjeux stratégiques. Le siège, les bureaux et les laboratoires s’installent à Saint-Gaudens, capitale administrative de cette nouvelle aventure industrielle. Le ministre des travaux publics, A. de Monzie, visite personnellement le chantier et remet la Légion d’Honneur à J.H. de Vries, directeur du projet.
La RAP hérite d’une mission claire : explorer et exploiter les richesses du sous-sol commingeois. L’État confie au Centre de Recherches du Pétrole du Midi, transféré de Montpellier, la gestion de cette opération. Quelques mois plus tard, en 1941, la RAP devient officiellement la structure permanente de cette aventure, avec ses propres ingénieurs géologues, ses maîtres-sondeurs, son personnel technique. À cette époque, l’effectif compte 15 ingénieurs géologues et maîtres-sondeurs, 43 employés et 255 ouvriers. Malgré les perturbations de la Seconde Guerre mondiale, qui crée une agitation sur le site, les forages se poursuivent. Quand la guerre éclate, deux mois après la découverte, une quinzaine de forages ont déjà été réalisés, les ingénieurs pétroliers français chassés de Roumanie par l’avancée nazie arrivent pour renforcer les équipes. Pierre Angot devient le premier président de la RAP en 1940-1941.
Forfait mobile responsable
Télécoop : 10€ de réduction sur votre premier forfait engagé. Avec le code promo Melles750, engagez-vous pour un forfait téléphonique mobile responsable.
L’aventure industrielle commingeoise
À partir de 1942, l’exploitation du gisement commence vraiment. Un pipeline est construit jusqu’à une usine de dégazolinage installée à Boussens en 1948 et mise en service en 1949. Boussens, village de 900 habitants, se transforme. Cette usine, la plus moderne d’Europe à son ouverture, transforme le gaz humide en gaz sec et produit quotidiennement 106 tonnes de carburant liquide, propane, butane et essence. Le 24 août 1939, un second décret délimite le périmètre d’exploitation. Dès 1942, avant la fin de la guerre, la transformation du gaz commence, avec une usine de dégazolinage provisoire installée à Peyrouzet, quinze kilomètres à l’ouest de Boussens, construite par la Compagnie Française de Raffinage.
La présence de l’industrie pétrolière transforme durablement la région. À Boussens, les installations s’étendent progressivement. Des bureaux de recherche pour ce qui deviendra Elf-Aquitaine s’y implantent après la guerre. En 1970, un centre d’essais de matériel pétrolier ouvre au Fourc, près de Boussens, avant de fermer en 1995 lors du départ des laboratoires. En 1983, au sommet de l’activité, ce sont presque 1000 salariés qui travaillent pour l’entreprise, dont 192 ingénieurs et cadres. L’usine chimique Sidobre-Sinnova et la cimenterie Lafarge complètent cet écosystème industriel. Entre 1938 et 1965, les effectifs de la RAP explosent, passant de 84 personnes à 1546 personnes.
Saint-Gaudens, la ville principale du Comminges, devient un centre prospère. Le nombre de commerces par habitant explose, rivalisant avec les villes les plus commerçantes de France. Les foreurs commingeois acquièrent une réputation internationale qui les propulse au-delà des frontières. Ils partent explorer les gisements d’Algérie, apportant leur expertise à la CREPS (Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara). Le premier forage saharien au Djebel Berga intervient en 1953-1954. Des découvertes majeures au Sahara surgissent : Edjeleh et Hassi Messaoud en 1956, puis Hassi R’Mel la même année. Ces ingénieurs et foreurs commingeois jouent un rôle central dans ces découvertes qui feront la richesse d’Elf-Aquitaine et son expansion mondiale. Boussens devient la base logistique pour les opérations sahariennes.
Randonnée et bien-être en montagne
Cimalp, marque drômoise de confiance, équipe les randonneurs avec du matériel adapté à la montagne. Découvrez leur gamme complète pour vos prochaines aventures.
L’oubli du Comminges
En 1966, la RAP fusionne avec d’autres structures pour former Elf-Aquitaine, un véritable géant industriel national. L’industrie du pétrole persiste, mais Saint-Marcet perd du poids face à d’autres gisements plus productifs. En 1993, Elf-Aquitaine réduit ses activités et délocalise ses opérations vers Pau, davantage orientée vers le gisement de Lacq en Pyrénées-Atlantiques, jugé beaucoup plus rentable avec ses réserves considérablement supérieures. L’usine de Boussens ferme en 1999 après cinquante ans d’activité, marquant l’écroulement d’une époque. Le centre de recherches de Boussens, qui avait connu son apogée avec des centaines de chercheurs, devient peu à peu un vestige industriel.
En 2009, le gisement de Saint-Marcet est officiellement considéré comme épuisé. L’exploitation prend fin après plus de soixante ans d’activité. Durant cette période, le gisement aura produit environ 7 milliards de mètres cubes de gaz, un volume respectable mais bien inférieur au géant de Lacq avec ses 247 milliards de m³. La transition progressive vers l’épuisement n’a pas été brutale, mais elle a été inexorable. Le Comminges revient graduellement à l’agriculture, au tourisme de montagne et à ses activités traditionnelles. Les puits se rebouchent. Les installations se démantèlent. Les traces du passage industriel disparaissent presque invisibles dans le paysage, comme si cette époque de prospérité n’avait jamais existé.
Mais cette histoire s’efface aussi de la mémoire collective de manière bien plus complète. Total, qui a absorbé Elf-Aquitaine suite à la privatisation en 1994, préfère écrire une histoire sans les chapitres commingeois encombrants. Cette région autonome de pétrole qui a donné naissance à l’un des plus grands groupes industriels français, cette pépinière d’ingénieurs et de foreurs qui ont bâti l’empire pétrolier français en Algérie et au Sahara, devient progressivement un détail oublié. Les raisons sont complexes : les scandales de la Françafrique, les complications de la décolonisation algérienne, les enjeux géopolitiques sensibles autour des intérêts pétroliers en Afrique. Total préfère une narration plus simple, une histoire nette et sans complications historiques.
Le film redonne voix à la mémoire
Tout est parti d’ici, réalisé par Vincent Barthe et Virginie Mailles-Viard, se pose en gardienne de cette mémoire oubliée. Dix ans de travail de réalisation, de recherche minutieuse et de collecte de témoignages avant la sortie en 2025. Le film plonge dans les archives, filme les paysages contemporains du Comminges, enregistre les voix émouvantes de ceux qui ont vécu cette époque. Des foreurs devenus ingénieurs, des cadres qui ont dirigé des équipes internationales, des habitants qui ont connu l’essor industriel et le déclin progressif. Chaque témoignage apporte sa pierre à l’édifice mémoriel.
Le documentaire ne cache pas les réalités complexes : les espoirs collectifs alimentés par la découverte, les conquêtes territoriales et technologiques, mais aussi les renoncements, les silences, les oublis volontaires. Il montre comment une profession a transformé des paysans et des bûcherons en foreurs compétents, en électriciens spécialisés, en ingénieurs estimés, en cadres responsables. Un véritable ascenseur social que peu se rappellent aujourd’hui, contrairement aux récits des villes pétrolières du Moyen-Orient ou d’Amérique du Nord. La spécificité française du Comminges reste ignorée, ensevelie sous le poids des années et des stratégies d’oubli.
Vincent Barthe explicite cet effacement : « On a constaté qu’il y avait une disparition de cette mémoire, que les gens ne se souvenaient plus qu’il y avait eu cette industrie du pétrole et du gaz au Comminges, que c’était le berceau du groupe qui deviendrait Total. » Cette amnésie collective intéresse les réalisateurs, ils veulent comprendre ses mécanismes et les documents. Total préfère oublier volontairement cette préhistoire complexe, entachée des scandales de la Françafrique, des problèmes politiques algériens, des complications éthiques des opérations pétrolières en Afrique du Nord durant la guerre de décolonisation.
Épicerie bio en ligne
La Fourche : profitez du code promo VOWENI52 sur votre épicerie bio en ligne. Produits frais, sélection rigoureuse, livraison rapide.
Rendez-vous mercredi 12 novembre aux cinémas Rex
Les cinémas Rex de Luchon proposent une ciné-rencontre exceptionnelle autour de ce documentaire. Mercredi 12 novembre 2025 à 20 h 15, la projection du film sera suivie d’une rencontre avec l’équipe de réalisation. C’est l’occasion de discuter directement avec Vincent Barthe et Virginie Mailles-Viard de ce travail de mémoire, de leurs motivations, de leurs découvertes lors de cette décennie d’enquête.
Cette présentation en ciné-rencontre donne toute sa dimension à l’événement. Le film n’est pas juste une projection passive. C’est un espace de dialogue, de partage d’expériences. Pour ceux qui ont des liens familiaux avec cette époque industrielle, qui ont des récits à transmettre, qui veulent comprendre cette page d’histoire régionale, cette rencontre offre un moment privilégié.
Le tarif d’accès est fixé à 7 euros, avec possibilité d’utiliser une carte d’abonnement. Pour les habitants de la région, particulièrement ceux du Comminges et des Pyrénées, c’est un moment culturel à ne pas manquer.
Banque verte et responsable
Green-Got : la banque verte pour une gestion d’argent écoresponsable. Bénéficiez de 2 mois gratuits avec le code promo Melles750.
Profiter de votre visite à Luchon
Votre visite aux cinémas Rex de Luchon pour cette ciné-rencontre offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir la station. Luchon bénéficie d’une position remarquable, au cœur des Pyrénées, avec accès direct à de nombreux sentiers et ressources montagne. Après le film, vous pouvez vous imprégner de l’atmosphère locale, parcourir les installations thermales historiques, explorer les paysages environnants.
Si vous envisagez un séjour plus long dans la région, des solutions de location vous permettent de vous installer confortablement à Luchon. De nombreuses propriétés offrent la possibilité de combiner découverte culturelle et détente montagne.
Découvrez les possibilités de location à Luchon pour transformer votre sortie cinéma en occasion d’explorer la région plus largement.
Un film d’histoire et de mémoire
Tout est parti d’ici est bien plus qu’un documentaire sur la découverte pétrolière. C’est un acte de résistance contre l’oubli, un effort pour redonnner dignité et reconnaissance à une page d’histoire locale que les grandes structures industrielles nationales ont choisi de taire. En 1939, le Comminges a offert à la France ses premières richesses énergétiques et les fondations d’un géant industriel. Cette mémoire mérite d’être préservée, discutée, transmise aux générations futures.